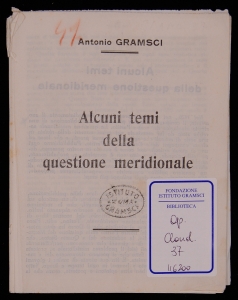Pour plus d'informations, voir Une Gramscipedia
Accueil
« Je dois faire comme font les naturalistes: à partir d'une dent ou d'un petit os de la queue, trouvé dans une caverne préhistorique, ils cherchent à reconstruire un animal disparu, qui, peut-être, était plus grand qu'une baleine »[1]
On lit et on étudie toujours Gramsci en fonction de son propre présent. On souligne, avec constance, son actualité, mais selon des points de vue très divers : celui du « marxisme classique », celui des « cultural studies » ou celui des « subaltern studies », celui du « post-marxisme », voire celui des diverses idéologies du néolibéralisme[2]. Aujourd'hui, cependant, Gramsci doit aussi être lu comme un auteur du passé, qu’il convient de resituer dans son contexte historique. La réalité sociale à laquelle renvoient les notions que ses interlocuteurs et lui utilisent, telles que celles de « masses » - « prolétaires » ou « travailleuses », et comprenant alors la « paysannerie » - est, par exemple, très différente de celle que nous mettons aujourd’hui sous le nom de « catégories populaires ». Il en va de même du marxisme de Gramsci : Gramsci ne « vient » pas du marxisme ; il décide, à un certain moment, à partir de 1917, de faire sien l’univers théorique du mouvement communiste international, c’est-à-dire le marxisme de Lénine, le « bolchevisme » ; il en accepte donc les catégories fondamentales, telles que la critique de la « démocratie bourgeoise », ou la « dictature du prolétariat », et il est toujours aventureux de vouloir l’entraîner dans les perceptions actuelles de ces questions, quand bien même mesurer l’écart existant entre sa propre approche et les conceptions qui deviendront canoniques, ou « orthodoxes », dans les années 1930, constitue un enjeu essentiel de sa lecture. De même encore, la notion de « producteur », centrale dans la réflexion de Gramsci, l'éloigne nécessairement, dans le contexte de l’époque, des problématiques environnementales contemporaines, et vouloir le confronter directement à ces questions ne peut qu’aboutir à des malentendus.
Sommaire
1926
L'année 1926, en raison précisément du contexte historique, constitue, dans la biographie de Gramsci, une date charnière. Gramsci est arrêté le 8 octobre et, à compter de cette date, cesse, en pratique, d'exercer ses fonctions de premier dirigeant du Parti communiste d'Italie (PCd’I), même s’il restera secrétaire général en titre jusqu’au congrès de Cologne en 1931. L’arrestation de Gramsci prend un sens qui dépasse l’aspect strictement biographique : l’événement s'inscrit dans le processus commencé avec la mort de Lénine en janvier 1924, et qui aboutira au « tournant » de 1929, lequel sanctionne la mainmise totale de Staline sur les destinées de l’URSS et du mouvement communiste international. La politique dite de « front unique », rassemblement politique, au-delà de la seule classe ouvrière, et autour d’elle, des forces sociales qui, dans leur diversité, sont dominées par la bourgeoisie capitaliste, est abandonnée au profit de celle dite « classe contre classe », qui oppose les partis communistes, « partis du prolétariat », à toutes les autres forces politiques. La sociale démocratie est désormais mise sur le même plan que le fascisme en pleine ascension. Cette politique, imposée sans ménagement au parti italien par l'Internationale communiste, rompt avec la ligne gramscienne adoptée lors du congrès de Lyon en 1926. Togliatti, l'un des artisans des « Thèses de Lyon », jusque là proche de Boukharine, et devenu de facto le premier dirigeant du parti italien, s'alignera à partir de 1929.
C’est également au tournant de 1930 que le marxisme, dans sa lecture léniniste, va devenir « orthodoxe ». Jusqu’à la mort de Lénine, le mouvement communiste avait eu à inventer son histoire, dans la conviction, partout dominante, que la révolution russe allait s’étendre rapidement aux puissance occidentales ; cette conviction était particulièrement forte en Italie et avait donné sa couleur particulière à ce qu’on a appelé le « biennio rosso », ces deux années, pendant lesquelles la société italienne, bouleversée par la guerre, hésite, et qui se termineront par les grandes occupations d’usine de l’automne 1920. Le bolchevisme était alors compris, non pas comme une méthode canonique, mais comme une solution ouverte, encore à construire. Avec la disparition de Lénine et les luttes qui s’engagent au sommet du nouvel État, avec le recul de la perspective d’une victoire socialiste rapide dans les pays capitalistes occidentaux, la situation change, mais, jusqu’à l’installation définitive de Staline, en 1928-29, demeure relativement indéterminée. Le fascisme, s’il est au pouvoir en Italie, n’est pas encore sûr de sa victoire – il ne le sera qu’après la résolution de la crise ouverte par l’affaire Matteotti –. En Allemagne, Hitler, après son échec en Bavière en 1923, est encore loin du pouvoir. En 1929, au contraire, lorsque Gramsci, en prison depuis deux ans et demi, commence la rédaction des Cahiers de prison, le « régime », en Italie, est solidement installé, le parti socialiste italien n’existe plus, le petit parti communiste est réduit à une poignée de militants clandestins, sa direction s’est réfugiée à Paris et s’est alignée sur la ligne stalinienne ; l’indétermination précédente, avec ses incertitudes et ses possibles, a disparu. Une époque est terminée. L’arrestation de Gramsci, sa condamnation en 1928 à une très lourde peine, participe de ce mouvement. Le projet, extrêmement élaboré, en théorie et en pratique, qu'il avait commencé à mettre en œuvre de manière méthodique et tenace depuis le début de 1924, est brutalement stoppé et ne sera ni repris ni poursuivi par ses successeurs.
Gramsci, en prison, aura conscience des changements intervenus, mais il ne pouvait en prendre la mesure comme nous le faisons aujourd’hui, nous qui savons qu’ils débouchèrent sur l’installation du nazisme en Allemagne, la seconde guerre mondiale et ses atrocités définitives, la victoire, enfin, des forces antifascistes et la création d’une Italie républicaine. Gramsci, mort en 1937, ne connût pas la dimension réelle des « grands procès » soviétiques et n’eut pas lui-même à en souffrir, comme cela eut été possible s’il avait eu le temps de rejoindre l’URSS après sa libération des geôles fascistes [3]. Il a, certes, perçu les dérives staliniennes, mais il n’a pas connu le stalinisme en tant que tel, il n’a pas pu prendre la dimension réelle de la transformation de l’idée qu’il avait lui-même de la « dictature du prolétariat » en système totalitaire. Bref, il ne pouvait avoir conscience du fait que sa propre arrestation participait de la fin d’une époque, participait d’une clôture, qu’elle avait aussi pour sens de notifier le non-avènement de possibles auquel lui-même travaillait.
Il ne faut donc pas lire la méditation gramscienne des Cahiers de prison comme une réflexion sur le tournant qui est en train de se produire, et notamment comme une théorisation de la « déviation stalinienne ». Gramsci, à Turi, continue à réfléchir sur les idées, les notions, les intuitions qu’il avait forgées au cours des années précédant son arrestation, dans un contexte très différent de celui des années 1930. Cela ne signifie pas, bien entendu, que les Cahiers ne feraient que répéter ce que Gramsci a déjà dit avant son arrestation : l'évolution de sa pensée est profonde, mais elle relève de la dynamique propre de cette pensée. Le paradoxe est que ces idées d’avant les années 1930, renaîtront après la guerre, tout d’abord à travers leur lecture et leur utilisation togliattiennes, ensuite, à partir des années 1970, à travers le développement des sciences sociales.
Le carteggio de 1926
Dans les jours précédents son arrestation, Gramsci a un échange de lettres avec Togliatti dans lequel on peut voir la « dent » ou le « petit os de la queue » à partir duquel les « naturalistes » reconstruisent tout un animal disparu : dans ce carteggio de 1926 – essentiellement deux lettres de Gramsci et deux lettres de Togliatti - se donnent à voir les expériences passées de Gramsci, les expériences en cours et les pistes qu’il explorera systématiquement dans les Cahiers. Les composantes essentielles de sa pensée sont ici à l’oeuvre, et tout d'abord sa conception du procès historique, régulièrement taxée de « bergsonisme » lors des polémiques et des discussions qui ont lieu au sein du mouvement socialiste italien au lendemain de la Grande guerre ; bergsonisme qui s’exerce par le biais de l’influence de Croce et de Sorel et qui renvoie à la notion bergsonienne de durée. Gramsci réagit, ici, au positivisme qui règne sur la pensée socialiste de son époque et traque l’esprit déterministe, mécaniste, l’esprit de discontinuité qu’il voit renaître constamment dans les démarches marxistes du temps.
Autre composante, qui constitue le ferment de cette conception gramscienne du procès historique : sa conviction qu'il existe un mouvement profond de transformation permanente des sociétés, qui est une donnée première de toute réflexion sur celles-ci et sur leur histoire ; or, ce mouvement est avant tout celui des larges masses populaires, il est formé des usages qu’elles créent, qu’elles développent, enrichissent, transforment, abandonnent…
C’est sur le fond de ces composantes fondamentales que se pose la question politique centrale, celle des « alliances », laquelle, pour le dirigeant marxiste qu’est Gramsci, renvoie à la notion léniniste d'« hégémonie », entendue comme « hégémonie du prolétariat », et est au principe de la réflexion sur la « Question méridionale » qu’il est en train de rédiger lorsqu’il est arrêté ; « l’hégémonie », mais aussi les thèmes et notions qui l'accompagnent : le « bloc historique », la question des intellectuels, la question religieuse...
Enfin, est présente au coeur du carteggio de 1926 l'expérience des « conseils d'usine » faite par Gramsci et ses amis lors du biennio rosso de 1919-1920 et au cours de laquelle se met en place l'inspiration « ordinoviste » de la démarche gramscienne, du nom de la revue que Gramsci crée au printemps 1919 avec Angelo Tasca, Palmiro Togliatti et Umberto Terracini, L'Ordine Nuovo.
En octobre 1926, au nom du Bureau politique du Parti communiste d'Italie, Gramsci adresse une lettre au Comité central du Parti communiste d’URSS, dans laquelle, tout en se rangeant aux côtés de la « majorité » représentée alors par Staline et Boukharine, contre « les oppositions » rassemblant Trotski, Zinoviev et Kamenev, il conjure tous les dirigeants soviétiques de se maintenir à la hauteur de leur responsabilité historique et d’éviter une rupture du « noyau léniniste » du parti russe, rupture qui découragerait les masses prolétaires et populaires hors d’URSS – et Gramsci pense, naturellement, aux ouvriers et aux paysans italiens – lesquelles perdraient la confiance qu’elles mettent dans l’idée qu’en URSS, c’est bien un État socialiste qui est en construction.
Togliatti, en poste à Moscou comme représentant du parti italien au Komintern, refuse de transmettre le courrier et répond, dans la lettre personnelle qu’il adresse à Gramsci, que la rupture en question est un état de fait et que ses effets ne sont pas si graves, ou, plus exactement, qu’ils ne remettent pas en question le « processus révolutionnaire » ; surtout, ajoute-t-il, on ne peut à la fois affirmer son soutien à la « majorité » et sembler la renvoyer dos à dos avec les « oppositions » quant aux responsabilités respectives des uns et des autres dans la rupture. Cette ambiguïté montre, selon Togliatti, que le Bureau politique du PCd’I, qui est soumis à de fortes pressions, est en train de « perdre ses nerfs ».
La réponse, personnelle, de Gramsci à Togliatti est sévère. Togliatti, depuis qu’il s’est installé à Moscou, semble ne plus pouvoir se dégager des luttes internes au parti russe et à l’Internationale ; son rapport aux « masses » - catégorie qu'il utilise en permanence, comme tous les acteurs du temps - est, selon Gramsci, devenu « abstrait ». En Italie, pour un communiste, les « masses » rassemblent toutes les classes sociales dominées, c’est-à-dire, non pas seulement les ouvriers, mais aussi les artisans, des éléments de la petite bourgeoisie, et, surtout, l'immense population des paysans pauvres. C’est avec cette réalité que, pour Gramsci, Togliatti a perdu le contact, puisqu’il ne perçoit pas ce que la question de l’unité du parti communiste russe, de l’unité du mouvement communiste international, a comme effets politiques directs sur les ouvriers italiens, et, bien plus, sur l’ensemble des catégories sociales identifiées comme populaires.
Togliatti, pour Gramsci, n'a plus la notion du mouvement historique global en quoi consiste le « processus révolutionnaire ». Dans la terminologie de l’époque, le « processus révolutionnaire » correspond à la « prise de conscience » collective, par la classe ouvrière, de sa place exacte, et de son rôle primordial dans le mouvement propre aux sociétés capitalistes, « conscience de classe » qui porte les prolétaires à prendre la place de la bourgeoisie dans la conduite de la société et à construire un État socialiste devant déboucher sur le communisme. Tout marxiste de l’époque partage peu ou prou cette conception, mais elle peut être déclinée de bien des manières. « L’ordinovisme », c’est-à-dire cet ensemble d’idées et d’analyses dont se réclament, parmi les quatre fondateurs de L’Ordine Nuovo, Gramsci, Togliatti et Terracini, constitue l’une de ces déclinaisons. C’est de cette inspiration que Togliatti s’éloigne, selon Gramsci.
« L’ordinovisme »
Le courant « ordinoviste » - on parle aussi de « conseillisme » - naît pendant le Biennio rosso, entre l’été 1919, date du « coup d’État rédactionnel » mené contre Tasca, au sein de la revue, par Gramsci et Togliatti, avec le soutien de Terracini, et la scission au sein du Parti socialiste italien (PSI) dont va naître le petit Parti communiste d’Italie en janvier 1921, et il se définit par la distance qu’il prend à la fois avec l’inspiration majoritaire au sein du PSI, le « maximalisme », officieusement et librement représenté à la rédaction de L’Ordine Nuovo par Angelo Tasca, et avec l’inspiration d’extrême gauche dont se réclament Amadeo Bordiga et son courant, qui prennent la tête du tout nouveau parti communiste et que Gramsci décide, bon gré mal gré, de soutenir. Gramsci ne cessera jamais de cultiver la dimension « ordinoviste » de sa propre réflexion, y compris lorsqu'il s'opposera directement à Bordiga, à partir de 1923, et prendra sa place, avec le « nouveau groupe dirigeant » formé en 1924.
Que ce soit contre les « maximalistes », contre Tasca ou contre Bordiga, il s’agit toujours, pour Gramsci, de combattre une conception qui tend à détacher une élite ouvrière - « aristocratie syndicale » ou « avant-garde » - des masses qu’elle « guide », et qui conduit, fondamentalement, à confiner ces masses dans une forme ou une autre de passivité, dans l’attente de la « crise » que le développement des contradictions du capitalisme produira.
Dans L’Ordine Nuovo, entre 1919 et 1920, Gramsci et ses camarades prônent au contraire une politique où la classe ouvrière cherche à imposer sa propre force immédiatement, là où se déroule avant tout la lutte de classe, c’est-à-dire au sein de l’entreprise, une action où les ouvriers disputent le pouvoir aux patrons dans l’atelier même, sans attendre la prise du pouvoir politique ; ils défendent pour cela la création de « conseils » au sein des usines, ouverts à tous les ouvriers, qu’ils soient « organisés » - c’est-à-dire syndiqués – ou non, et ayant vocation à prendre en charge la gestion même de la production, ainsiqu'une politique visant à rassembler, autour de la classe ouvrière – ou « derrière » celle-ci, l'ambiguïté n'est pas encore levée - les autres catégories sociales dominées, en particulier la paysannerie pauvre. Gramsci fait ainsi du lieu de production – l’usine, l’atelier, mais aussi les champs – le coeur du « processus révolutionnaire », et résume cela par l’idée que c’est en tant que producteur que le prolétaire prend conscience de sa place et de son rôle historique.
Sous cet angle, il n’y a pas, en apparence, de distance entre Gramsci et Togliatti en 1926 et leur accord a été sanctionné par les dites « Thèses de Lyon », c’est-à-dire les résolutions adoptées lors du congrès du Parti communiste d’Italie à Lyon en janvier 1926. Il ressort, cependant, du carteggio de 1926, que, chez Gramsci, la réflexion qui sous-tend « l’ordinovisme » met en jeu une conception du mouvement des sociétés bien plus complexe que ce qu’en comprenaient ses divers interlocuteurs, une conception de l’histoire qui recèle des perspectives, des aperçus, dont il est difficile, alors, dans le cadre du marxisme pratiqué au sein de l’Internationale communiste, de percevoir l’horizon véritable, les limites, les effets retardés, la dynamique profonde. Togliatti aura l’intuition de cette profondeur, tout au long de sa fréquentation de Gramsci, qu’il s’agisse du personnage de chair dont il a été proche, ou du texte gramscien qui l’accompagnera jusqu’à sa propre disparition en 1964, mais la pensée profonde de Gramsci, dans ses fondements comme dans ses implications, reste pour lui, en 1926, et restera dans bien des dimensions, un monde à découvrir.
Il faut le redire : pour Gramsci, les « masses » ne sont pas une multitude amorphe, ou une matière dont les propriétés se réduiraient à la forme que lui impose la contrainte extérieure, quelque chose comme « la forme de l’eau », qui est d’abord celle de son contenant. Les masses sont animées d’un mouvement propre, autonome parce que premier ; le mouvement des sociétés, c’est-à-dire le mouvement d'innovation et de transformation permanente des « couches populaires » qui constituent la vraie matière des sociétés mêmes, est un donné fondamental, au même titre que le monde naturel. Il s’apparente, comme cela a été alors tant reproché à Gramsci, à cet « air du temps » qu’est « l’élan vital » bergsonien. C'est sans doute cette dimension particulière de la démarche gramscienne qui restera, dans son économie propre et dans ses effets théoriques retardés, largement incomprise, voire structurellement incomprise, du marxisme « orthodoxe » mis en oeuvre par le mouvement communiste et les grands partis qui composent celui-ci au lendemain de la guerre et dans les années 1950-1960.
Gramsci a grandi à Ghilarza, bourg de la Sardaigne profonde, au sein d’une famille qui, bien que non paysanne, appartenait au monde rural de la fin du 19e siècle, dans un milieu bilingue, entre le sarde et l’italien[4], et il sera toujours attentif aux manifestations concrètes de la vie des classes populaires, de ceux qu’on appelle les « subalternes » : les formes d’organisation sociale par lesquelles se mettent en place les solidarités, les systèmes d’aide, les différents modes d’expression collective, les fêtes, les activités de divertissement, les formes populaires de la vie religieuse. L’intérêt de Gramsci pour le « folklore » n’a rien lui-même de « folklorique », il s’enracine dans sa propre vie, dans ce qu’a été son propre quotidien. C’est à cette « pâte humaine », perpétuellement en mouvement, en évolution constante, que peut renvoyer, chez lui, la notion d’« élan vital », et c’est dans ce cadre que se met en place sa propre conception des luttes de classes, de la vie politique, du mouvement de l’histoire et du « processus révolutionnaire », c’est-à-dire, dans le contexte du marxisme, la prise de conscience par la classe ouvrière, par le prolétariat, de son rôle historique spécifique, qui doit conduire, à un certain stade, à la prise du pouvoir politique, à la construction d’un État socialiste et, enfin, au communisme. Gramsci ne se contente pas de reprendre les concepts et les schémas du marxisme classique, tels qu’ils sont en train d’être développés par les révolutionnaires russes, il les traduit dans sa propre vision profonde du mouvement social. Les « Conseils d’usine », traduction « en italien » des soviets russes, sont ainsi, aux yeux de Gramsci, non pas simplement une forme d’organisation proposée par des militants s’inspirant de ce qui se passe en Russie, mais une émanation du mouvement ouvrier en Italie et c’est là ce qui leur confère leur portée politique.
Cette théorie de « l’émanation » sera développée par Gramsci et ses amis lorsqu’ils reprendront à Bordiga la direction du petit Parti communiste d’Italie, à partir de 1924. Elle sera au coeur des « Thèses de Lyon », adoptées lors du congrès de janvier 1926 et qui dessinent les contours de ce que peut être un parti bolchevique « à l’italienne ». C’est Togliatti lui-même qui énonce l’idée que le parti communiste n’est pas, comme le définit Bordiga, un « organe » de la classe ouvrière, mais une composante de celle-ci, qu’il « émane » de celle-ci. L’« organe » politique auquel pense Bordiga rassemble des militants peu nombreux, entraînés, disciplinés et totalement dévoués, venant non seulement du prolétariat lui-même, mais aussi des autres couches sociales dominées et de ces « déserteurs de la bourgeoisie » que sont certains intellectuels[5] (tels que lui-même ou les jeunes ordinovistes turinois). Cet « organe » a pour mission d’unir les différentes composantes du prolétariat et de conduire celui-ci vers son destin, mais la synthèse est, ici, apportée de l’extérieur. Pour Gramsci, l’organisation proprement politique du prolétariat naît du sein même de celui-ci, là où son rôle prend sens, c’est-à-dire dans l’usine, et comme une conséquence du mouvement des Conseils, lorsque ceux-ci, par la lutte qu’ils mènent pour disputer le pouvoir au capitaliste dans l’atelier, sont conduits à affronter directement le pouvoir politique des capitalistes, l’État bourgeois, et donc à sortir de l’usine. C’est dans le cadre de ce mouvement, né et grandi dans l’usine, que se réalise, par le biais du parti, la synthèse des éléments divers qui composent le prolétariat et, au-delà, les « masses », c’est-à-dire la synthèse de l’ensemble des couches populaires. Dans ce cas, cependant, non seulement la synthèse n’a pas son principe à l’extérieur de la classe ouvrière, mais elle se réalise par le mouvement d’organisation même de celle-ci : la grande synthèse du mouvement populaire se met en place sous la forme de « l’hégémonie du prolétariat ».
« L’hégémonie du prolétariat », la grande alliance ouvriers-paysans
Gramsci a entraîné ses camarades Togliatti et Terracini, fondateurs avec lui et Angelo Tasca de L’Ordine Nuovo, dans l’élaboration de cette conception, au cours du biennio rosso, à partir de l’été 1919, en les convainquant de réaliser avec lui un « coup d’État rédactionnel » contre Tasca ; il les a de nouveau rassemblés, contre Tasca encore, mais aussi contre Bordiga, à partir de la fin de 1923, dans l’effort explicite, que résument les « Thèses de Lyon », de « traduction » du bolchevisme dans l’univers du mouvement ouvrier italien. Il n’y a pas, sur cette conception de l’organisation communiste comme « partie de la classe ouvrière », élément de la classe ouvrière, émanation de celle-ci, de désaccord entre lui et Togliatti : on l’a dit, c’est Togliatti lui-même qui rédige la plus grande part des « Thèses de Lyon » et qui défend cette idée.
Pourtant, à partir du moment où Togliatti s’installe à Moscou, pour représenter le PCd’I au Komintern et faire partie de l’Exécutif de celui-ci, immédiatement après le Congrès de Lyon, un écart va apparaître entre les deux hommes, qui s’élargira jusqu’à la discussion d’octobre 1926. Cet écart porte sur l’inspiration conseilliste – ordinoviste - de la conception gramscienne du bolchevisme, et ses conséquences, ses effets sur la pratique et la réflexion politique des deux dirigeants. Ainsi, pendant tout le printemps 1926, on note une mésentente persistante entre Togliatti à Moscou et le bureau politique du PCd’i, dirigé à Rome par Gramsci, à propos de la manière de faire vivre les luttes ouvrières au sein des entreprises : Gramsci veut faire des « comités d’agitation » dont la création a été décidée par le Congrès de Lyon, des structures prenant la suite des Conseils d’usine des années 1919-1920, et dont la vocation est à ses yeux, pour le dire brièvement, de rassembler les ouvriers dans leur diversité, dans leur hétérogénéité, à partir de leur statut de producteurs. Togliatti, de son côté, qui se fait ici l’interprète de l’Exécutif de l’Internationale, et face aux difficultés pratiques énormes de la lutte dans les entreprises en régime fasciste, veut faire de ces comités d’agitation un moyen de relance de la lutte syndicale et de conquête des organisations syndicales.
Le débat tendra alors à opposer le « réalisme » de Togliatti à la vision théorique abstraite, quoique profonde, de Gramsci - et c’est ainsi qu’il a été en général présenté et commenté - mais, en vérité, ce qui est alors en question pour celui-ci, c’est l’idée même d’ « hégémonie du prolétariat », laquelle, à ses yeux, fait partie du socle fondateur du « léninisme ».
La question de l’ « hégémonie du prolétariat » est toujours liée à celle de l’alliance politique de la classe ouvrière avec la « paysannerie », pour reprendre le terme de l’époque. En Russie, cette notion est opératoire en particulier dans le cadre de la « nouvelle politique économique », la NEP, mise en place à partir de 1921 et qui réintroduit, sous contrôle, un fonctionnement capitaliste pour une part de la production agricole. Or, la « question paysanne » est précisément l’un des points qui, selon Gramsci, rapproche l’Italie des années 1920 de la Russie d’avant 1917 : dans un cas comme dans l’autre, le prolétariat industrialisé est minoritaire par rapport à la paysannerie pauvre, qui constitue une masse dans la masse. Aussi bien cette question paysanne fait-elle partie des points de discussion et de désaccords théoriques sensibles qui opposent les différents courants du mouvement ouvrier italien au lendemain de la guerre. Le courant « maximaliste », dirigé par Serrati, qui domine le PSI, est, dans le principe, hostile aux revendications de redistribution des terres régulièrement formulées par les petits paysans, les paysans pauvres, en particulier par les paysans salariés des grandes propriétés latifundiaires du sud de l’Italie (les braccianti) : il y voit une entorse à la doctrine communiste et une emprise des idées capitalistes. Au cours de l’année 1926, le débat sur la NEP au sein du parti bolchevique russe est extrêmement vif : les « oppositions », c’est-à-dire les courants représentés par Trotski, Zinoviev et Kamenev, qui disputent le pouvoir au sein du parti à Staline et Boukharine, en ont fait l’un de leurs chevaux de bataille : la NEP, selon eux, avec ses conséquences, à savoir la réapparition d’une classe de « riches » propriétaires, les « koulaks », est en train de dévoyer l’expérience soviétique et il faut y mettre fin. Gramsci, au mois de septembre 1926, polémique avec les rédacteurs du journal Il Mondo, journal émanant des milieux radicaux, que l’on pourrait qualifier aujourd’hui de « centre gauche » - il s’agit du courant animé par Giovanni Amendola -, lesquels soutiennent que l’URSS est en train de redevenir un pays capitaliste « comme les autres ». Gramsci défend alors la NEP, signalant ainsi clairement son approbation de la ligne politique suivie par la « majorité » du Comité central du Parti communiste russe – c’est-à-dire la ligne politique de Staline et Boukharine – et il s’efforce de montrer que le point qui reste décisif pour ce qui se passe en Russie est le processus global de construction d’un État socialiste, processus que la NEP, à ses yeux, parce qu’elle est mise en œuvre sous le contrôle ouvrier rendu possible par l’alliance de la classe ouvrière et de la paysannerie - « l’hégémonie du prolétariat » -, ne met pas en danger, ne dénature pas.
Dans la réflexion politique de Gramsci, cette problématique de l'alliance repose sur l'idée que, si, comme l’expérience des occupations d’usine de 1920 l’a montré, le prolétariat italien ne peut seul prendre le pouvoir et doit trouver des alliés auprès des paysans pauvres, c'est lui, cependant, qui, en tant que classe sociale, peut donner satisfaction aux revendications paysannes. C’est au prolétariat italien qu’il revient de prendre en charge la libération des paysans, en particulier dans le Mezzogiorno, de la domination et de l’exploitation qu’ils subissent, et qui s’exercent sur eux à travers le système d’alliance conclu entre les industriels du nord et les grands propriétaires terriens.
Au moment même où il défend la NEP contre les rédacteurs de Il Mondo, en septembre-octobre 1926, Gramsci travaille à son texte sur la « question méridionale », qu’il n’aura pas le temps de terminer, mais qui deviendra cependant un texte de référence dès les années 1930, après sa publication en l’état par Togliatti. Il y développe une réflexion sur la structure sociale propre au Mezzogiorno et la dimension « nationale » de la « question méridionale », dans laquelle figurent nombre des idées qu’il développera plus tard dans les Cahiers de prison, sur le « bloc historique », sur le rôle des « intellectuels », sur celui de l’Église et, enfin, sur la question de « l’hégémonie ».
La « question méridionale » et le « corporatisme de classe »
Dans ces notes d'octobre 1926 sur la question méridionale, Gramsci met ainsi en oeuvre la distinction essentielle, qui sera plus tard théorisée dans les Cahiers, entre rôle « dirigeant » et rôle « dominant » exercés par une classe sociale. Une classe au pouvoir dirige les groupes sociaux qui lui sont alliés et domine ceux qui sont ses adversaires : la bourgeoisie capitaliste dirige les groupes sociaux à ses marges – petite bourgeoisie, petits et moyens propriétaires terriens, employés, artisans, etc. -, et domine ceux qui, dans la lutte des classes, lui sont directement opposés, c’est-à-dire, en premier lieu, les ouvriers, mais aussi, en Italie, les paysans pauvres. Elle domine en exerçant le pouvoir politique, à travers l’État et ses moyens de coercition, elle dirige en exerçant une hégémonie, culturelle, idéologique, en construisant un consensus, fondé sur ses propres représentations, sur ce que Gramsci établira et développera dans les Cahiers, à l'aide de la catégorie de « sens commun ».
Le prolétariat, minoritaire en Italie parmi la « population travailleuse », ne peut donc accomplir sa vocation historique – prendre la place de la bourgeoisie et construire un État socialiste en instaurant une « dictature du prolétariat » – que s’il « réussit à obtenir le consensus des larges masses paysannes » ; pour devenir une classe « dominante », c’est-à-dire une classe disposant du pouvoir politique et qui soumet, par sa « dictature », ses adversaires, à savoir la bourgeoisie capitaliste, le prolétariat doit devenir une classe « dirigeante », capable de conduire vers ses propres buts – lesquels prennent en charge l’intérêt commun - l’ensemble de la « population travailleuse », ce qui ne peut se faire par la coercition. « Les communistes turinois s'étaient posé concrètement la question de l'« hégémonie du prolétariat », celle de la base sociale de la dictature du prolétariat et de l'état ouvrier. Le prolétariat peut devenir la classe dirigeante et dominante dans la mesure où il parviendra à créer un système d'alliances de classes qui lui permettra de mobiliser contre le capitalisme et contre l'état bourgeois la majorité de la population laborieuse, ce qui, dans le cas de l'Italie, compte tenu des rapports réels qui existent entre les classes, revient à dire dans la mesure où elle réussira à obtenir l'assentiment des larges masses paysannes. » [6].
Ce rôle « dirigeant », le prolétariat ne peut l'exercer qu'à certaines conditions. La première est qu'il soit uni en son propre sein : les différentes catégories de prolétaires doivent avoir conscience d’appartenir à une seule et même classe sociale ; les ouvriers ne doivent plus se considérer d’abord comme métallurgistes, ou menuisiers, ou maçons, mais comme prolétaires, c’est-à-dire membres d’une classe sociale vouée à un rôle historique, à laquelle la place centrale qu’elle occupe dans la société confère une vocation particulière, un devoir propre, celui de représenter l’intérêt commun, et de prendre, pour cela, la tête du mouvement social.
Cette centralité de la classe ouvrière, cette place et ce rôle spécifique, impliquent, pour être compris par les ouvriers eux-mêmes, qu’ils accèdent à une manière indépendante de penser leur rapport aux autres catégories sociales, une manière qui repose, précisément, sur la capacité à distinguer la classe ennemie – la bourgeoisie capitaliste – des groupes sociaux avec lesquels la forme juste du rapport est l’alliance. Ces groupes sont constitués des « semi-prolétaires » urbains - petits artisans, domestiques, petits employés – et de la masse immense des paysans pauvres, bref, ils rassemblent, aux yeux de Gramsci, tout ceux qui partagent avec les prolétaires un certain mode de vie, un certain rapport au travail, un statut de subalternité sociale, et qui sont, en même temps, des producteurs, ou qui sont liés socialement à des producteurs.
Les paysans pauvres ne peuvent pas unir autour d’eux les groupes sociaux dominés par la bourgeoisie capitaliste – représentée, en Italie, par les industriels du Nord et les grands propriétaires terriens du Sud - : malgré leur masse, ils constituent un groupe social fragmenté, « désagrégé », ce qui est un effet même de la direction politique exercée sur eux par la bourgeoisie, laquelle s’efforce d’empêcher toute organisation autonome des masses qu'elle maintient dans la subalternité, et en particulier toute convergence vers le prolétariat. Cette sujétion des paysans et des semi-prolétaires à la bourgeoisie se traduit, chez les masses paysannes du Mezziogiorno, par la conviction – ou la croyance - que leurs exploiteurs sont indifféremment, à travers l’État romain, les ouvriers et les patrons du Nord : tous des « signori »... Gramsci a lui-même connu ce sentiment, lorsque, lycéen à Cagliari, il se sentait proche des revendications indépendantistes sardes et reprenait le mot d’ordre « les continentaux à la mer ». Il a lui-même parcouru, en se liant au mouvement ouvrier turinois, le chemin menant du préjugé anti-ouvrier présent dans les masses méridionales, à l’idée de l’alliance nécessaire entre paysans méridionaux et ouvriers septentrionaux.
Bref, l’alliance prolétaires-paysans ne peut se faire qu’à l’initiative du prolétariat et sous son égide : le prolétariat est seul en mesure de développer une pensée autonome, la pensée des producteurs, qui naît et se forme sur le lieu même de la production, dans l’usine. Le rôle du prolétariat, tel que l’entend Gramsci, consiste donc à s’unir lui-même, ce qui advient lorsque l’ouvrier se pense comme prolétaire avant de se penser comme métallurgiste ou menuisier, à unir la « population travailleuse », à rassembler autour de lui les « semi-prolétaires » et, surtout, la « paysannerie », c’est-à-dire, en Italie, la grande masse inorganisée et fragmentée des paysans méridionaux, et cela suppose qu’il parvienne à briser le préjugé anti-ouvrier chez les paysans, qu’il parvienne à faire comprendre au paysan que le prolétaire est le principal ennemi de son propre ennemi : le grand propriétaire allié au patron de l’industrie.
Il doit pour cela savoir se comporter en vrai « dirigeant » : il lui faut construire sa propre vision d’ensemble du mouvement de la société, autonome par rapport à celle de la bourgeoisie ; une vision dans laquelle les rapports des groupes sociaux entre eux et leurs rôles sont clairement établis selon leurs logiques respectives. Or, cet effort passe par la capacité du prolétariat à se défaire lui-même de tout « corporatisme de classe » : ce corporatisme ouvrier qui se traduit par l’idée que les paysans du Mezzogiorno sont des barbares, inaptes par nature à prendre en charge leur propre sort et, a fortiori, la « chose publique », qu’ils sont un « boulet » qui freine le développement des potentialités industrielles dont les ouvriers sont eux-même les fers de lance.
La nécessité de la lutte contre le corporatisme ouvrier était fortement soulignée dans les « Thèses de Lyon » et se trouvait au coeur de la polémique dans laquelle Gramsci était engagé avec les rédacteurs de Il Mondo, au moment où il rédige ses notes sur la question méridionale. Il s’agit là d’un point essentiel, qui met en jeu une attitude spécifique à l’égard des « alliés » sociaux : l’alliance suppose une vision à long terme, une compréhension du processus social et la prise en compte de l’autonomie relative des catégories composant les masses : ce n’est pas par la coercition que l’on peut réaliser l’alliance avec les paysans, mais en leur fournissant le moyen de penser d’une autre façon, en énonçant l’autre point de vue – celui du prolétaire - et en l’énonçant de manière à ce qu’ils puissent l’entendre, en laissant se développer, enfin, comme une fonction même du processus, la prise de conscience de celui-ci.
Éradiquer, chez le paysan du Mezzogiorno, « le préjugé […] par lequel il voit dans le nord de l’Italie un seul bloc d’ennemis de classe »[7], confondant ouvriers et patrons comme agents de l’exploitation qu’il subit, et détruire « chez l’ouvrier industriel le préjugé que lui a inculqué la propagande bourgeoise, selon lequel le Mezzogiorno est un boulet de plomb qui s’oppose aux plus grandioses développements de l’économie nationale » [8], telles sont les conditions précises de l’hégémonie du prolétariat en Italie et telle est, pour Gramsci, la mission politique que le tout jeune parti communiste d’Italie doit accomplir.
Le « processus révolutionnaire » tel que l’entend Gramsci met donc en jeu deux points essentiels. En premier lieu, l’idée que le processus est celui-là même de la prise de conscience, par le prolétariat, de son propre rôle historique, c’est-à-dire la prise de conscience du processus lui-même. C’est ici toute la question de l’historicisme de Gramsci qui est posée, et, secondairement, celle de sa place dans l'histoire du marxisme italien et de son rapport à l’hégélianisme, via le rôle de Benedetto Croce dans la pensée italienne de son époque.
Cette idée nourrira la réflexion des Cahiers de prison : elle est au coeur, notamment, de la lecture originale que Gramsci fait de Machiavel et des développements qu’il en tire à propos du parti communiste défini comme le « nouveau prince ».
En second lieu, le processus, chez Gramsci, est toujours historique, c’est-à-dire en acte. La vision positiviste, mécaniste, déterministe, du processus révolutionnaire décomposé en une succession d’étapes, ordonnées selon un schéma canonique, avec en son centre la prise du pouvoir politique, dénature le processus historique lui-même, tout en en faisant partie : elle relève du processus contradictoire par lequel le capitalisme se maintient et se développe. Ainsi, la capacité à saisir le processus en acte, dans sa continuité, sans que sa décomposition en étapes statiques ne le rompe et ne l'arrête, telle est, pour Gramsci en 1926, la vraie condition de la prise de conscience du prolétariat ; là se joue le conflit théorique entre le système de représentations « bourgeois » et le système de représentations « prolétaire ». C’est en cette capacité que se résume l’idée gramscienne du lien entre théorie et pratique.
Cette « intuition » du processus, pour reprendre la terminologie bergsonienne usuelle à l’époque, nourrit, elle aussi, la réflexion des Cahiers : elle fonde en particulier la conception gramscienne si importante de la « molécularité », du « changement moléculaire ».
On l’a déjà dit, la réflexion de Gramsci repose sur l’idée que l’élan populaire qui transforme en permanence les sociétés est un donné premier. Le perpétuel mouvement des masses précède et détermine toutes les formes d’organisation des sociétés et toutes les représentations sociales [9]. De nombreux éléments se conjuguent pour former chez Gramsci cette approche fondamentale du mouvement social, mais l’une d’entre elles se détache de manière originale : c’est, en effet, le Gramsci linguiste qui théorise le social, au sens où, pour lui, la langue, qui évolue en permanence, qui n’est jamais arrêtée, participe du mouvement social primordial et le donne à voir. Gramsci a été l’étudiant de Bartoli et a été formé à la linguistique géographique et historique, il a lu Bréal, sans doute aussi Meillet, il a certainement participé, par l’intermédiaire de Bartoli, à l’enrichissement, pour le sarde, du Romanisches etymologisches Wörterbuch de Meyer-Lübke[10]. Cette dynamique spécifique de la question linguistique dans la réflexion de Gramsci trouve, dans les Cahiers, son propre développement à travers la question de la traduction, de la « traductibilité ». On sait que Gramsci a été un traducteur passionné, mais, au-delà de l’exercice, la traduction chez lui a une fonction complexe et profonde : c’est ici que se joue la spécificité de l’interprétation gramscienne de la dialectique marxiste.
C'est ainsi que le carteggio de 1926 nous immerge dans ce que l'on pourrait appeler la biodiversité gramscienne. Biodiversité qui renvoie à la multiplicité des questions et des thèmes abordés, à la forme même des Cahiers, où se mêlent remarques et jugements très personnels et réflexion für ewig, mais qui tient aussi à la tension permanente qui s'y exerce entre le cadre général dans lequel s'inscrit très consciemment Gramsci - à la fois celui du marxisme et du « faire politique », comme on dirait en italien, du mouvement communiste international, et celui du débat intellectuel académique - et l'inspiration propre de Gramsci, sa « manière de voir », qui, en permanence, menace de rompre le cadre. Cette tension n'est jamais résolue dans les Cahiers et elle constitue en elle-même leur dimension essentielle. C'est à cette lumière qu'il conviendrait d'étudier la lecture imposée par Togliatti après la guerre et la manière dont Gramsci est entré dans le débat intellectuel de la fin du XXe siècle et d'aujourd'hui.
- ↑ Lettre de Gramsci à sa mère du 24 février 1929, citée par Naomi Ghetti, Gramsci nel cieco carcere degli eretici, L'Asino d'oro edizioni, 2014, p. 14
- ↑ Sur les lectures de droite de Gramsci, voir, par exemple : Vito Carofiglio et Carmela Ferrandes, « Les aventures de la droite française et les avatars de Gramsci », Mots. Les langages du politique, n° 12 pp., mars 1986, 191-203
- ↑ Gramsci avait prévu de s'installer en Sardaigne après sa libération : il avait demandé à sa soeur Teresina de lui trouver une maison à Santu Lussurgiu, où il espérait pouvoir se reposer et rejoindre ensuite plus facilement sa femme et ses enfants à Moscou.
- ↑ voir à ce sujet : Luigi Matt, « La conquista dell’italiano nel giovane Gramsci », in Fiamma Lussana, La lingua/le lingue di Gramsci e delle sue opere: scrittura, riscritture, letture in Italia e nel mondo : atti del Convegno internazionale di studi, Sassari, 24-26 ottobre 2007, Rubbettino editore, 2008, pp.51-63
- ↑ Paolo Spriano, Storia del partito comunista italiano – I – Da Bordiga a Gramsci, Einaudi, 1967, p. 480
- ↑ Quelques thèmes de la question méridionale, https://www.marxists.org/francais/gramsci/works/1926/10/gramsci_19261000.htm
- ↑ Ibid.
- ↑ Ibid.
- ↑ Un article de Gramsci écrit en 1918 dans L'Avanti ! à propos de l'Espéranto, indique clairement combien cette conviction profonde est au principe de toute la réflexion de Gramsci : « Toute couche sociale qui émerge dans l'histoire, qui s'organise pour la bonne bataille, introduit dans la langue des courants nouveaux, des usages nouveaux, et fait éclater les schémas fixes que les grammairiens ont établi par commodité occasionnelle d'enseignement. Il n'y a rien dans l'histoire, dans la vie sociale, de fixe, de rigidifié, de définitif. Et il n'y aura jamais rien [de tel]... ». Cité in Franco Lo Piparo, Lingua intellettuali egemonia in Gramsci, Laterza, 1979, p. 83. Gramsci reviendra sur la question de l'Espéranto dans les Cahiers de prison
- ↑ sur tout cela voir : Giancarlo Schirru, « Antonio Gramsci studente di linguistica | Fondazione Gramsci onlus », Studi storici, L II, 2011, p. 925–73